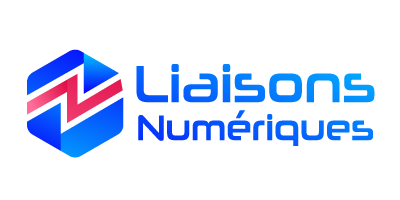À la question de savoir qui a vraiment inventé le RSS, personne ne s’accorde. Les débats sont vifs, les versions s’entrecroisent, les ego s’entrechoquent. Les spécialistes de l’histoire numérique n’ont toujours pas réussi à trancher. Des noms circulent, des versions s’opposent, et derrière chaque évolution du standard se devinent des alliances, des désaccords, des visions du web qui s’affrontent.
Derrière le sigle RSS se cache un principe simple : permettre à chacun de suivre, sans effort, les nouvelles publications de ses sites préférés. Ce système de syndication de contenu, tour à tour baptisé “Really Simple Syndication” ou “Rich Site Summary”, a bouleversé la manière d’accéder à l’information en ligne. Plus besoin de cliquer frénétiquement de page en page : les flux RSS rassemblent, dans un format unique, les titres, extraits et liens vers les articles de centaines de sites, accessibles en un clin d’œil depuis un agrégateur.
L’émergence du RSS n’a rien d’un hasard dans l’évolution du World Wide Web. Dès les premiers jours du web, Tim Berners-Lee, l’homme du CERN à qui l’on doit le web et la création du W3C, pose les jalons d’un réseau ouvert, où les standards facilitent la diffusion du savoir. Sur ce terreau fertile, les protocoles, à commencer par le TCP/IP, ont permis une expansion fulgurante des échanges et une circulation fluide de l’information.
Sur le plan technique, un flux RSS est tout simplement un fichier XML proposé par un site, actualisé à chaque nouvelle publication. Les lecteurs RSS, qu’il s’agisse de logiciels dédiés ou de modules intégrés au navigateur, consultent ces fichiers à intervalles réguliers et affichent instantanément les dernières actualités. Ce fonctionnement, pensé pour échapper à tout enfermement propriétaire, s’inscrit dans une logique décentralisée où l’utilisateur garde la main sur ce qu’il souhaite consulter.
Pour mieux situer le RSS dans le grand puzzle de l’histoire d’internet, voici quelques repères marquants :
- Le réseau ARPANET, qui précède internet, naît dans les laboratoires américains des années 1960-1970.
- Tim Berners-Lee choisit de laisser le web libre d’accès, créant un précédent et ouvrant la voie à des innovations collectives.
- L’apparition de RSS 1.0 marque une étape décisive dans la standardisation de la syndication de contenu sur le web.
Derrière l’invention : une histoire de passionnés du web
À la fin des années 1990, une poignée de développeurs s’engagent pour offrir au web un outil de syndication libre. Parmi eux, Aaron Swartz détonne. À peine adolescent, il rejoint le groupe chargé d’élaborer RSS 1.0, alors que le web tâtonne encore. Swartz ne s’arrête pas à la technique : il insuffle une culture du partage et de la transparence qui va irriguer toute une génération d’internautes.
L’histoire du RSS, c’est celle d’une communauté rassemblée autour d’une idée forte : l’information doit circuler sans entrave. Autour de Swartz gravitent des figures comme Lawrence Lessig, l’architecte des licences Creative Commons, ou John Gruber, l’initiateur du Markdown. Ces pionniers défendent un internet où la propriété intellectuelle s’assouplit et où la collaboration prend le pas sur le contrôle. Swartz, lui, multiplie les projets : de Creative Commons à Reddit, qu’il cofonde avec Steve Huffman et Alexis Ohanian, il place l’accès au savoir au-dessus de tout.
Guidé par la vision d’un web sans clôtures, Swartz marque le mouvement open source de son empreinte. Son implication, relayée par une génération de codeurs, continue d’alimenter les débats autour de la diffusion des connaissances et du logiciel libre. Le RSS, né de cette dynamique, porte la marque d’un engagement collectif où la technique sert une cause bien plus vaste.
Derrière l’invention : une histoire de passionnés du web
À la croisée de l’engagement militant et de l’innovation technologique, Aaron Swartz occupe une place à part. Dès ses quatorze ans, il contribue à la spécification RSS 1.0 et s’impose rapidement comme un défenseur du libre accès à la connaissance. Pour Swartz, le code n’est pas une fin en soi : il lutte, main dans la main avec d’autres activistes, contre la privatisation du savoir scientifique et la mainmise des plateformes sur l’information.
En s’associant à la création de Demand Progress, Swartz s’engage dans des batailles politiques, notamment contre la loi SOPA qui menaçait la neutralité du net. L’un de ses actes les plus marquants : le téléchargement massif d’articles scientifiques sur JSTOR pour dénoncer une logique qui réserve la connaissance à quelques-uns. Ce geste lui vaut des poursuites et soulève une question brûlante : jusqu’où peut-on entraver l’accès au savoir au nom du droit d’auteur ?
Swartz ne limite pas son combat aux sciences : il plaide aussi pour un accès public aux textes de loi et la transparence des décisions publiques, fondant une partie de son action sur la notion d’open law. Son parcours, ponctué d’initiatives marquantes, continue d’inspirer ceux qui pensent que la société numérique ne peut avancer sans droits fondamentaux ouverts à tous.
Pourquoi le RSS continue de compter dans l’histoire d’Internet
Le RSS a su traverser les époques. Discret, il irrigue encore la circulation de l’information sur la toile. Son fonctionnement place l’usager au centre : fini les contenus filtrés par des algorithmes souvent opaques, le RSS offre un accès direct, sans interférence, aux articles et actualités des sites choisis.
Ce format s’inscrit dans la droite ligne de l’idéal porté par les fondateurs du web comme Tim Berners-Lee : la circulation libre, sans entrave, de l’information. Le RSS prolonge cette vision, s’appuyant sur des licences souples, comme les Creative Commons, et un standard ouvert qui garantit la compatibilité et la pérennité des contenus partagés.
Dans un contexte où les plateformes centralisées imposent leur grille de lecture, le RSS reste l’une des rares technologies open source qui protège l’indépendance des créateurs et de leur public. Chercheurs, journalistes, institutions publiques ou simples curieux : tous trouvent dans le RSS un moyen de contourner la personnalisation forcée et l’éphémère. Sa robustesse, sa simplicité et son universalité continuent d’ouvrir des perspectives, là où l’arbitraire algorithmique se referme.
Voici ce que permet concrètement le RSS aujourd’hui :
- Un accès direct à l’information, affranchi de la publicité et du traçage
- Un respect accru de la propriété intellectuelle, grâce notamment aux licences Creative Commons
- Une compatibilité étendue à tous les environnements numériques
Le RSS ne s’est jamais contenté de faire circuler des titres : il a permis à toute une génération d’oser imaginer un web où chacun reste maître de ses choix et de son temps. Une technologie qui, loin d’avoir dit son dernier mot, continue de rappeler que l’accès à l’information n’est pas négociable.